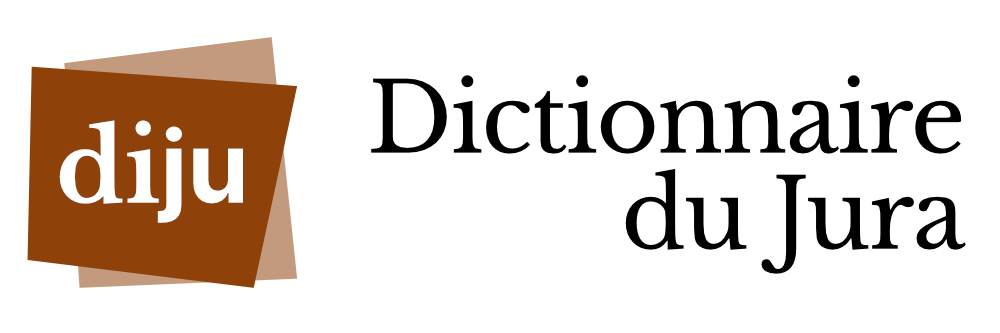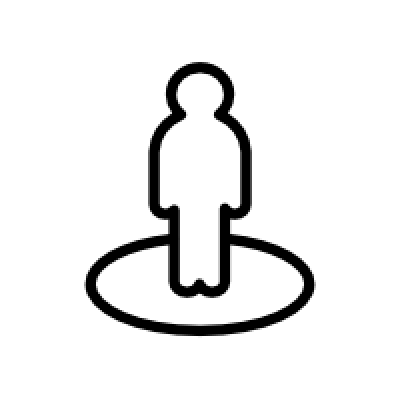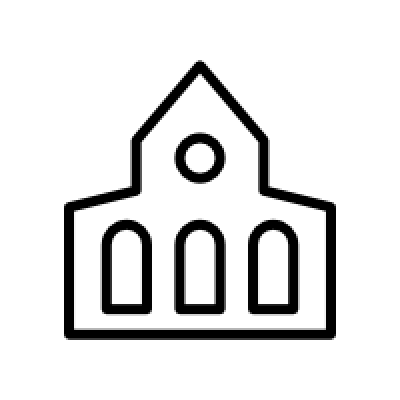Originaire d'Epauvillers. Né le 29 octobre 1860 à la ferme du Maran, près de St-Ursanne. Quatrième enfant d’une fratrie de dix. Décédé le 1er août 1934 à Soubey. Catholique romain. Prêtre.
Enfance et scolarité à Ederswiler, Foussemange (F), Epauvillers et Delémont. A l’âge de quinze ans, il quitte le progymnase de Delémont pour suivre les cours privés du curé François Challet. Études classiques à Luxeuil (F) et à St-Maurice (VS). Service militaire à Colombier (NE). Grâce à une bourse, il peut s’inscrire en théologie chez les jésuites au Collège germanique et à l’Université pontificale grégorienne de Rome. Ordonné prêtre le 26 octobre 1886 à Rome.
Sa formation complétée, M. exerce sa profession de prêtre d’abord à Rome, pour devenir vicaire à Delémont peu après (1887). En 1890, il est nommé curé à Tramelan, où il est le premier à réintroduire le culte catholique après la Réforme. Dès 1891, il fait partie des intransigeants d’Ernest Daucourt, adversaires des catholiques conciliants de Mgr Joseph-Xavier Hornstein qui cherchent à lisser les différences avec Berne après les déchirures du Kulturkampf. M. lance notamment une campagne de soutien en faveur d’Ernest Daucourt, alors préfet de Porrentruy, et l’aide ainsi à devenir président de la Commission catholique.
Las du travail dur qu’implique la reconstruction d’une commune catholique en terre protestante, M. postule pour la cure de Courfaivre. Installé là-bas en 1898, il y assume diverses fonctions telles que la gestion d’une copieuse bourse d’études – appelée « le stipendium Démange » –, le secrétariat du Syndicat agricole local et un siège à la Commission d’école et au Conseil paroissial. Il s’adonne également au journalisme et publie une Chronique jurassienne dans La Liberté ainsi que des chroniques agricoles sous le pseudonyme de « Rusticus » dans L’Impartial, journal dont il est le correspondant.
Après quelques années à Courfaivre, M. se retrouve au cœur d’une sordide affaire politico-sexuelle, qui aboutit à la perte de son poste à la cure, tout en le laissant impuni au niveau légal ainsi qu’indemne dans son statut professionnel en tant que membre du clergé bernois et curé.
Dès sa prise de fonction à Courfaivre, le curé se mêle très activement à la vie politique et à divers litiges au sein de sa commune, commençant en 1899/1900 par une action en justice contre l’avocat et homme politique Justin Citherlet, qu’il accuse d’avoir disposé à tort du stipendium Démange au profit de son propre fils. L’affaire est le premier cas d’une longue série de conflits qui feront de Citherlet son ennemi juré.
En 1905, une ancienne servante du curé porte plainte contre lui pour avoir été chassée de sa maison sans salaire et sous un faux prétexte. Elle l’accuse d’ailleurs d’abus sexuels, qui auraient mené à une grossesse. Le prêtre est sommé par l’évêque Mgr. Haas de venir à Soleure dans le but de transiger avec la victime afin d’éviter que l’affaire ne soit traduite devant un tribunal. Le différend est réglé par voie de médiation et M. doit payer une indemnisation. De surcroît, l’évêque demande que le curé s’installe dans une autre commune et lui interdit de recevoir des pénitents à la sacristie. Mgr. Haas meurt peu après et ne peut donc s’assurer de l’exécution de ses ordres, ce qui permet à M. de garder sa position à Courfaivre.
En 1908, il est élu au Conseil de paroisse. Un conflit au sujet de l’électrification de l’église éclate aussitôt entre lui et Justin Citherlet. Dans ce contexte, M. est accusé d’avoir prononcé un sermon à connotation politique dans l’église et d’avoir ainsi tenté d’influencer ses paroissiens en abusant de sa position de curé. La veille des élections communales du 2 janvier 1909 – avec Justin Citherlet et Joseph Girardin en lice pour la mairie –, M. prononce un nouveau sermon qui lui vaut des accusations d’influence illégitime, de partialité (pour Girardin) et d’intimidation, et qui sera suivi d’un interrogatoire devant le préfet, qui est occupé à mener une enquête pour découvrir d’éventuelles irrégularités électorales. Tandis que les élections de 1909 sont annulées, répétées, à nouveau contestées puis finalement validées en deuxième instance par les autorités cantonales (au détriment de Citherlet, qui se retire au second tour) et que M. voit enfin « son » candidat nommé à la mairie, la réputation du prêtre se détériore sur un autre front. En effet, M. se brouille avec son ancien partisan Ernest Daucourt, qu’il attaque dans le Franc-Montagnard, ce qui amène à un litige devant la justice. Dans le même temps, il est accusé de s’être livré à des voies de fait sur une personne handicapée, et les rumeurs sur sa conduite immorale refont surface dans la presse. Dans cette situation, le prêtre recourt de nouveau à ses talents d’orateur. Le jour du Jeûne fédéral (19.09.1909), il énonce un sermon qui fait scandale et dont ses adversaires disent qu’il menace et intimide les fidèles en prêchant malheur et perdition pour tous ceux qui oseraient s’opposer au prêtre. Début octobre, un père de famille affirme que ses filles auraient subi de graves atteintes à leur intégrité sexuelle de la part du curé. Une plainte pour facturation de prestations indues à la commune, voie de fait, engagement politique hors mesure et transgression des bonnes mœurs, signée par onze citoyens (dont Justin Citherlet) et demandant la révocation immédiate du curé, est envoyée au Conseil-Exécutif en date du 11 octobre 1909. Ce dernier ordonne une enquête et nomme Ernst Schürch comme commissaire spécial pour la mener à bout. Avant et durant cette procédure, de nombreuses pétitions et attestations sont signées en faveur du curé, les deux parties interrogées à plusieurs reprises, les victimes présumées des actes violents et abusifs auditionnées et publiquement dénigrées, de nombreux témoins sollicités, jusqu’à l’évêque de Bâle, Mgr. Stammler, qui est interrogé et mène d’ailleurs des enquêtes de son côté. La ligne de défense de M. se base essentiellement sur la dénégation des accusations, le dénigrement des accusatrices et la dénonciation d’un complot politique dont l’initiateur serait Citherlet, tandis que ce dernier maintient un flux constant de correspondance adressé aux différentes autorités impliquées dans l’enquête. Celle-ci dure jusqu’en avril 1910. Basé sur le rapport Schürch, le Conseil-Executif formule une demande de révocation à l’attention de la Cour suprême, à laquelle incombe la décision finale. Dans le même temps, on propose à M. de démissionner avant la déposition officielle de cette demande – une démarche qui lui permettra de garder son statut de membre du clergé bernois et lui assurera l’éligibilité comme curé dans une autre paroisse.
M. démissionne et célèbre sa messe d’adieux le 12 juin 1910 dans l’église de Courfaivre. Il quitte le village le 15 juin, accompagné jusqu’à Delémont par un cortège de cérémonie formé par ses partisans. Il continue à jouir d’un fort soutien d’un grand nombre de paroissiens, qui organisent une sorte de grève d’église en boycottant la messe célébrée par son suppléant. Au début du mois d’août 1910, une photo-portrait de M. est distribuée aux villageois en souvenir de son temps à la cure. Le 28 août 1910, il est réélu curé par l’assemblée paroissiale de Courfaivre, mais l’évêque de Bâle menace de l’excommunier au cas où il accepterait cette nomination et M. finit par y renoncer.
M. devient ensuite prêtre auxiliaire à Bünzen (AG) en 1910. On le retrouve curé de Pfeffingen dès l’année suivante (1911-1924). Sa postulation à la cure de Montsevelier en 1919 lui est pourtant refusée par l’évêque. En 1925, il est nommé à la paroisse de Soubey, qui est inoccupée depuis trois ans. L’évêque Stammler souscrit à cette nomination, mais des doutes liés aux affaires de Courfaivre surgissent dans la Commission catholique. Finalement, la nomination est confirmée et M. garde son poste de curé à Soubey jusqu’en 1933, soit une année avant son décès.
Membre de la Société jurassienne d'Émulation (SJE), il est l'auteur de trois articles parus dans les Actes : La Faune du Jura (1908 et 1909), Le château de Pfeffingen et les comtes de Thierstein (1915) et Notes sur le Château d'Angenstein (1916). M. était aussi un chasseur passionné.
Auteur·trice du texte original: Emma Chatelain (2005) et Kiki Lutz (2020), 23/11/2005
Dernière modification: 06/06/2024
Bibliographie
Littérature spécialisée
- Eugène Folletête, « Rauracia Sacra. Première partie », in Actes de la SJE 1931, vol. 36, 1932, p. 177.
- Actes de la SJE 1934, vol. 39, 1935, pp. 220-221.
- Jean-Claude Prince, « C’est le curé qui m’a perdue. » L’affaire Léon Maître, un scandale dans le Jura à la belle époque, Neuchâtel : Editions Alphil, 2019.
Sites internet
- cathberne.ch, s.d. (consulté le 6 juin 2024).
Liens Metagrid.ch
Suggestion de citation
Emma Chatelain (2005) et Kiki Lutz (2020), «Maître, Léon (1860-1934)», Dictionnaire du Jura (DIJU), https://www.diju.ch/f/notices/detail/2950-maitre-leon-1860-1934, consulté le 18/01/2026.